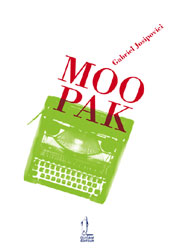|
| Le Golem, photographie de Damien Massart |
Les Allusifs inaugurent une nouvelle collection d'ouvrages de petit format abordant les peurs sous leurs formes les plus diverses. Si l'on connaît essentiellement l'écrivain français Pierre Jourde pour ses essais critiques, dont La Littérature sans estomac est l'une des pièces les plus marquantes, La Présence- ayant vu le jour en mars dernier- nous présente une facette fort intrigante de son oeuvre.
Un homme revient dans la maison de son enfance, nichée dans un minuscule village au fin fond de l'Auvergne. Désormais laissée à l'abandon, la bâtisse fait désormais figure de capharnaüm où les objets au rebut amassés au fil des décennies témoignent de l'absence des personnes auxquels ils sont associés. La bêche ou la casquette, prolongements des mains ou de la tête du travailleur sont les témoins discrets d'une absence habitée.
Ainsi, loin de rassurer, l'inertie de ces reliques perpétue un silence pesant qui, la nuit tombée, devient une oppression de tous les instants, laissant la porte ouverte à l'imagination la plus vagabondante. Les chaises désormais délaissées appellent à leur suite tout un cortège de revenants, les cloisons et les serrures suscitent la pression des spectres qui souhaitent réinvestir la demeure calfeutrée. Les placards quant à eux rappellent les apparitions clownesques de l'enfance, avec tout le lot d'imprévisibilités qu'elles éveillent et à travers l'image de défiguration de l'humanité qu'elles incarnent. Par son absence de repères, la nuit suggère une infinité de présences incapables de se matérialiser tout à fait, et qui sont pour cette raison d'autant plus redoutables.
La langue gracile de Pierre Jourde sonde les présences dans leur insaisissable pouvoir d'attraction. Il mène au cours de son texte une réflexion indéniablement passionnante sur le processus de réactions suscitées par des situations inquiétantes, dans le silence et la solitude les plus totales. On reste captivé d'un bout à l'autre du récit par cette faculté d'exprimer l'innommable, de faire ressurgir des impressions si étranges et qui pourtant nous sont si familières, de démontrer à quel point les objets peuvent catalyser la peur et faire participer notre inconscient.
« Plus j'allais profond, plus la raison et la vie sociale me paraissent éloignées. Je me livrais à la sauvagerie et aux prodiges. Il ne s'agissait pas exactement de surnaturel, ni de croire que pouvaient se produire des choses impossibles dans ce monde ordinaire que je laissais derrière moi. Il s'agissait plutôt d'une sorte de suspension, comme lorsqu'on lit un roman. Au fond de la forêt, le monde se dépouillait progressivement de ce que l'on a coutume de nommer la réalité. Il se mettait entre parenthèses. L'impossibilité devenait son état ordinaire, sa substance. »En pénétrant les entrailles de la forêt qui avoisine la maison familiale, le narrateur tente d'effectuer à rebours le parcours de son enfance, d'approcher de nouveau les témoins du passé pour s'infiltrer dans les interstices du temps. Cette activité diurne lui permet aussi en quelque sorte d'exorciser les présences impalpables qui, la nuit durant, le confrontent aux peurs les plus enracinées dans son esprit. Tandis que dans l'obscurité, la présence se manifeste par son absence même, par son activité insidieuse, par l'obligation sous-jacente de lui donner vie, elle se veut ici moins terrorisante dans la mesure où elle doit subir la démarche d'un homme qui part à sa rencontre. D'espionne des ténèbres, elle devient sujet dépouillé de sa terrifiante invisibilité.
La langue gracile de Pierre Jourde sonde les présences dans leur insaisissable pouvoir d'attraction. Il mène au cours de son texte une réflexion indéniablement passionnante sur le processus de réactions suscitées par des situations inquiétantes, dans le silence et la solitude les plus totales. On reste captivé d'un bout à l'autre du récit par cette faculté d'exprimer l'innommable, de faire ressurgir des impressions si étranges et qui pourtant nous sont si familières, de démontrer à quel point les objets peuvent catalyser la peur et faire participer notre inconscient.