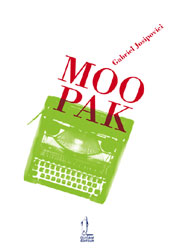|
| Gravure de Francisco Goya |
Errer sans fin pour trouver un sens à la vie, telle est la quête obstinée des personnages qui parcourent les oeuvres de Jean-Pierre Martinet.
Dans L'Ombre des forêts, le dernier roman du natif de Libourne, c'est au destin croisé de Céleste, Monsieur, et de Rose Poussière auquel nous sommes confrontés. Cependant, à Rowena, ville fantôme à peine esquissée située à la frontière franco-allemande, les hommes se côtoient mais ne se voient pas. Ils aimeraient exister, mais ce droit leur est constamment refusé.
Si Céleste est au service de Monsieur, elle n'a jamais le plaisir de recevoir les ordres et autres directives qui pourraient lui octroyer une certaine forme d'importance au sein de la demeure.
Au triste sort qui lui est réservé, elle prendrait davantage de plaisir au rôle de martyre. Ainsi, envisage-t-elle de subir son assassinat perpétré par Monsieur:
"Tout serait fini. Elle ne resterait plus là, aussi inutile qu'un objet au rebut ou un vieillard tremblotant dans un hospice, à guetter vainement, des heures durant, parfois même des journées entières, un signe de vie, une voix, rien qu'une voix humaine, intimant des ordres, même absurdes, mais des ordres comme en reçoivent tous les domestiques depuis des siècles et des siècles."Monsieur, quant à lui, se sent vivant lorsqu'il décachette le courrier des précédents locataires, désormais disparus, lui donnant ainsi l'impression d'habiter à la fois notre monde et celui des défunts. Pour ne pas voir sa domestique, il évite scrupuleusement d'emprunter l'accès principal. Chez Martinet, c'est dans la proximité avec ses congénères que la solitude s'établit. Amère palliatif de ces ténèbres sans fond, Globe Sale, éclaire sans discontinuer la chambre de Monsieur, lui donnant le sentiment d'avoir un compagnon à ses côtés, avec ses états d'âmes, ses caprices et son emprise sur sa vie intérieure.
Rose Poussière a quant à elle élu domicile dans un hôtel mal famé, au nom de Saratoga. Jadis, elle s'appelait Edwina Steiner, avant d'avoir réchappé aux camps de concentrations. Enfin, elle en est persuadée, même si personne ici ne croit un traître mot à ses sornettes. A l'abri des regards et des tourmentes du ciel, elle aimerait vivre, emportant toujours son parapluie avec elle.
Quand l'un des membres de ce trio met les pieds dehors, c'est à un ballet fantasmagorique auquel nous assistons, composé d'ombres chinoises qui se découpent aux fenêtres, de figures macabres fouillant au sein des poubelles pour dresser une collection de bas, de soupirants donnant des rendez-vous imaginaires, ou même de voix venant de nulle part. Thelonious Monk et son Crepuscule with Nellie n'est jamais très loin des oreilles de Monsieur.
Les pantins qui parcourent l'Ombre des forêts, naviguant entre songe et paranoïa, ressemblent à s'y méprendre à un Peuple des miroirs, titre repris pour le recueil de textes critiques de Jean-Pierre Martinet, réédité l'année passée chez France-Univers. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si ces derniers se réfugient parfois dans leur propre reflet afin de prendre conscience de leur existence. Comme la négation de la vie est pire que la moindre des péripéties, de l'acte le plus atroce, Monsieur fantasme sur une vie de tueur en série qui ferait la une des journaux, rêvant de voir apparaître son visage en première page des gazettes. Pour inaugurer sa piètre carrière, il n'hésitera pas à abattre un chien qui ne demandait pas son reste. Vivre quelque chose, peu importe quoi, mais au moins, avoir le sentiment d'être quelqu'un, de palpiter, de chavirer, d'être emporté quelque part, peu importe la destination, que ce soit ici ou là, le paradis ou l'enfer, la terre ou le ciel. "Emportez tout, mais laissez-moi l'extase" comme disait Emily Dickinson.